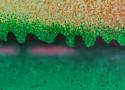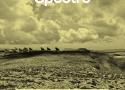Interdiction de : l'abaya/robes longues, du calot, du voile, contrôle des bouteilles en plastique dans les toilettes de la RATP. Harcèlement, discriminations, calomnies, essentialisation, licenciements abusifs, contrôles au faciès, lois d'exception contraires à un État de droit, menace de mort d'un nouveau-né. Tel est le quotidien des musulmans,ou personnes assimilées comme tel, en France.
Contre un État qui ne résoudra jamais la crise climatique, et sa violence que la force ne saurait aujourd’hui renverser, que reste-il aux écologistes ? L’anarchisme, historique et présent, plein d’idées pour un autre futur.
Le mythe selon lequel l’État serait au service de l’intérêt général se craquelle de toutes parts. À force de voir l’État s’entêter à défendre des projets aussi désastreux économiquement et écologiquement que l’autoroute A69, à force de voir sa police déchaîner sa violence contre les opposants aux projets privés écocidaires de mégabassines, de plus en plus de militants écologistes se désillusionnent.
Aux citoyens qui apprennent brutalement à « faire le deuil de l’État », répond une série d’essais et d’ouvrages qui, ces derniers mois, ont contribué à dépoussiérer cette hypothèse : et s’il était possible de faire advenir une société de justice sociale et écologique sans passer par la conquête de l’État ? Et même contre lui ?
«Essayez la dictature», déclarait Macron en 2020. Au pays de Charlie, nous y sommes déjà, à bas bruit.
Les vieillards réactionnaires qui occupent les plateaux télé ont raison : «On ne peut plus rien dire». Ces éditorialistes sont ridicules, car on n’entend malheureusement que leurs idées moisies sur toutes les chaînes de télévision depuis des années. Ils se prétendent censurés alors que la seule vraie pensée unique, c’est la leur.
En revanche, en France en 2025, on ne peut plus tenir le moindre discours critique à l’égard du gouvernement, plus manifester, plus émettre la moindre réserve contre le patronat, plus dénoncer le racisme… Bref, c’est vrai : on ne peut plus rien dire. Quelques exemples sidérants ces derniers jours.
Fournir sa photographie et ses empreintes quand on demande son passeport ou sa carte d’identité est plus lourd de conséquence que ce qu’on imagine. Ces données, qui sont enregistrées dans le fichier des « titres électroniques sécurisés » (TES) sont récupérées par la police par un contournement de la loi. La Quadrature du Net a pu obtenir des témoignages et preuves formelles de l’utilisation abusive de ce fichier pour identifier des personnes lors d’enquêtes judiciaires. Nous avons alerté la CNIL sur ce scandale qui était malheureusement prévisible, tant ce fichier TES portait, par son existence même, les risques d’un abus de surveillance par l’État.
Des dizaines de milliers de lampes pour éclairer des chemins agricoles, plantations, sentiers ou jardins privés, distribuées gratuitement grâce à l’argent de la transition énergétique. Le dispositif des Certificats d’économie d’énergie (CEE) est au cœur d’une (nouvelle) énorme gabegie et d’une vaste fraude, devenue de plus en plus visible ces derniers mois.
Dans cet épisode exceptionnel de L’Œil de Moumou, Aymeric Caron revient sur ce qu’il décrit comme « l’un des plus grands scandales moraux et médiatiques de notre époque » : le traitement de la guerre à Gaza. L’ancien journaliste, devenu député, parle sans détour du rôle des médias français, de leur silence et de leurs compromissions.
« On a laissé faire un génocide, affirme-t-il d’une voix calme mais ferme. Et les médias français, au lieu de dénoncer, ont préféré détourner le regard. Ce silence-là, c’est une trahison. »
Caron, qui fut longtemps chroniqueur dans des émissions à forte audience, ne cache pas son désarroi face à ce qu’il appelle « la dérive du journalisme spectacle ». Il cite nommément certaines chaînes : « CNews viole la loi chaque jour, en diffusant des discours de haine ou de désinformation. Et pourtant, l’Arcom ne fait rien. On laisse prospérer une parole qui déshumanise. »
Pour l’auteur de Antispéciste, la question dépasse Gaza : elle touche à la responsabilité morale de ceux qui informent. « Être journaliste, ce n’est pas faire de la com’ pour le pouvoir ou l’armée, c’est mettre la lumière sur ce qu’on veut cacher. »
Interrogé par Mourad Guichard sur la réaction du monde politique, Caron se montre tout aussi sévère : « Quand le président de la République parle d’un “droit d’Israël à se défendre”, sans jamais prononcer le mot Palestinien, il envoie un message terrible. Ce discours a justifié l’injustifiable. »
Mais derrière la colère, transparaît une forme de désillusion. « Je ne me remettrai jamais de Gaza », confie-t-il. « Ce que j’ai vu, ce que j’ai lu, ce silence assourdissant… Tout cela m’a profondément bouleversé. »
Pour lui, l’enjeu n’est pas seulement politique, mais humain. « Les images de Gaza, on aurait dû les montrer en boucle, parce qu’elles nous obligent à regarder en face notre propre responsabilité. À force d’ignorer la souffrance des autres, on finit par perdre notre humanité. »
Dans cette discussion intense, Moumou lui demande s’il garde espoir. Caron hésite, puis répond : « Tant qu’il y aura des gens qui refusent le mensonge, qui cherchent la vérité, oui, il reste de l’espoir. Mais il faudra du courage. Parce qu’aujourd’hui, dire la vérité, c’est devenu un acte de résistance. »
Encore un budget de guerre sociale. Encore un gouvernement qui piétine les plus fragiles. Et encore cette même comédie : les syndicats supplient, les partis comptent les voix, les éditos progressistes s’indignent à demi-mot. Mais cette fois, quelque chose pourrait échapper à leur contrôle. Un appel en-dehors des organisations, avec un mot d’ordre clair : Boycott, Désobéissance, Solidarité. Et une date : le 10 septembre. Et derrière, un refus massif de jouer le jeu des institutions mortes. Alors forcément, la machine à décrédibiliser ce mouvement s’est déjà mise en route. Selon les gardiens officiels de l’ordre progressiste, cet appel serait confus et relayé par l’extrême-droite. Mais il est temps d’arrêter de se rassurer avec des fictions. Ce système ne tombera pas sous les coups des pétitions, des motions de censure, des élections ou des grèves perlées. Il tombera peut-être sous les coups d’une classe sociale qui a de moins en moins à perdre.
Chaque année, 211 milliards d’euros d’argent public sont versés aux entreprises… souvent sans aucune contrepartie. Pendant qu’on traque les "assistés", qui profite vraiment du système ? Un rapport explosif du Sénat répond.
211 milliards d’euros par an, un des plus gros budget de l’État, impossible de revenir dessus… mais quel service public est-il si gigantesque ? Ces 211 milliards d’euros par an représentent les aides aux entreprises ! C’est le résultat de la commission d’enquête sur les aides publiques aux entreprises au Sénat. Les sénateurs se sont d’abord confrontés à une grosse opacité autour des aides aux entreprises : “la lobbyiste Agnès Verdier-Molinié a avancé au doigt mouillé l’estimation de 28 milliards d’euros, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, lançait lui 150 milliards”, raconte l’Humanité.
Au final, elles englobent les aides budgétaires, fiscales, et les exonérations de cotisations patronales. Le groupe CRCE-K au Sénat revendique que les aides soient transparentes et surtout que “l’argent public ne soit pas reversé aux actionnaires”, c’est à dire que les aides servent à l’investissement et aux emplois plutôt qu’à faire fructifier une entreprise déjà rentable, qui ensuite va délocaliser ; on connaît bien le schéma ici. Le groupe CRCE-K propose que les aides soient évaluées pour savoir comment elles sont utilisées. Le problème ce ne sont pas les aides mais à qui et à quoi elles servent, analysent Thomas Porcher et Lisa Lap.
En effet, quand d’un côté l’État tente d’aller chercher quelques milliards sur les chômeurs, retraités, malades ou pauvres ; de l’autre, les grandes entreprises reçoivent de l’argent public sans contrepartie, et se permettent même d’augmenter leurs dividendes ou faire des plans de licenciement. “Ces entreprises n’ont pas besoin de l’argent public”, affirme l’économiste.
Après 1 an et demi où Javier Milei est au pouvoir en Argentine, le leader d’extrême droite ultra libéral a-t-il sauvé le pays comme il le prétendait ? Non, et ce sont les argentins qui en pâtissent. Le Président argentin, admiré par la droite et l’extrême droite française, a un bilan catastrophique.
La police tue :
Entre 1977 et 2022, 861 morts suite à l’action des forces de l’ordre, dont 27 lors d'opérations anti-terroristes, et 80 du fait d'un agent en dehors de son service
Les forces de police et de gendarmerie ont pour mission d’assurer la sécurité des personnes, des biens et des institutions. À ce titre, elles disposent du pouvoir de recourir à la force et d’utiliser leurs armes à feu, dans des circonstances précises. Ce pouvoir, conféré par l’État, occasionne des morts. Qui sont-ils, pourquoi et comment sont-ils tués ? Dans quelles conditions l’action des forces de l’ordre se révèle-t-elle fatale ?
Réprimer c'est faire des choix politiques et c’est aussi une méthode de gouvernement. De la protection de la "chose publique" à la lutte antiterroriste, en passant par la gestion carcérale de la délinquance ordinaire, on retrace ce soir les transmutations de la répression d'État avec la chercheuse Vanessa Codaccioni qui vient de publier "Comment les États répriment" aux éditions Divergences
Nouvelles lois, amendes, éléments de langage médiatiques... Dans un rapport, Amnesty International analyse la stratégie méthodique des autorités françaises pour réprimer les militants écologistes.
La diffusion du rapport parlementaire sur « l’entrisme islamiste » en France et l’influence supposée des Frères musulmans marque une étape supplémentaire dans le développement de discours et d’actes visant la communauté musulmane dans notre pays. Outre de nombreuses fragilités méthodologiques, ce rapport témoigne plus généralement d’une approche complotiste qui présente des parallèles évidents avec la rhétorique antisémite du début du XXème siècle.
Au cœur d’une lutte devenue majeure pour le mouvement écologiste, le chantier de l’A69, un temps suspendu par la justice, pourrait reprendre prochainement. Pour vous aidez à y voir clair dans les rebondissements judiciaires et manœuvres parlementaires de ces derniers jours, Rapports de Force fait le point. Et éclaire les perspectives de mobilisation.
Ce fut une journée de basses manoeuvres à l’Assemblée nationale. Lundi 2 juin, un texte de loi devait être discuté afin de valider les autorisations environnementales liées au projet d’autoroute entre Castres et Toulouse, l’A69, et ainsi relancer un chantier vivement contesté depuis plus de deux ans. Or, le texte a été rejeté par ceux-là même qui l’avaient proposé, afin d’être renvoyé directement en commission mixte paritaire où il a toutes les chances d’être adopté. Une façon de contourner le débat parlementaire, donc de passer en force, estiment les détracteurs du projet.
Jeudi 15 mai, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à relancer les travaux de l’autoroute A69, suspendus par la justice. Le vote de plusieurs sénateurs socialistes en faveur de ce texte inquiète et divise la gauche.
« C’est un affront à la représentation parlementaire ! » Christine Arrighi, députée écologiste de la Haute-Garonne, ne décolère pas. Jeudi 15 mai, le Sénat a largement adopté une proposition de loi pour reprendre les travaux de l’A69 et ainsi contourner la décision de justice du tribunal administratif de Toulouse. Et ce, avec les votes de treize sénateurs socialistes, tandis que le reste du groupe s’abstenait, et qu’un seul votait contre.
En février dernier, la justice avait annulé le projet autoroutier, estimant qu’il ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur dans le dossier. L’État a fait appel de cette décision et plusieurs parlementaires du Tarn, dont le sénateur Philippe Folliot et le député Jean Terlier, avaient décidé dans la foulée de surenchérir en proposant un texte au Parlement pour inscrire l’intérêt public de l’A69 directement dans la loi et ainsi contourner la décision du tribunal.
On aurait préféré que ce soit un poisson d’avril : dans une décision rendue ce 1er avril 2025, le Conseil d’État a validé le principe de la censure arbitraire et opaque d’un réseau social. Derrière l’apparente annulation de la décision du Premier ministre de l’époque, Gabriel Attal, de bloquer Tiktok, la plus haute juridiction française offre en réalité le mode d’emploi de la « bonne censure ». Cette décision est inquiétante, tant cette affaire aura montré l’inefficacité du Conseil d’État à être un rempart efficace contre le fascisme montant.
Il devrait commencer à être assez clair, quand des milices défilent dans Paris au cri de « Paris est nazi », et poignardent des militants de gauche, que ce vers quoi nous nous dirigeons mérite d'être appelé « fascisme ». C'est clair, et en même temps pas encore si clair. Tant qu'un concept n'en aura pas été proposé, le fascisme restera une évocation historique intransposable.
Dans cette interview, réalisée pour le podcast Los monstruos andan sueltos, Verónica Gago analyse la portée de ce qu’elle définit comme « restauration patriarcale » et fait référence au processus de masculinisation de la politique : « Des composants politiques alliés continuent à mettre la progression de l’extrême-droite sur le dos des féminismes ».