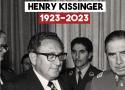Cinquante ans ont passé depuis le coup d’État du 11 septembre 1973. Les images de la Moneda en flammes, le palais présidentiel, les regards terrorisés des prisonnières et prisonniers du stade national à Santiago ou encore les sinistres lunettes noires du général Pinochet restent imprimées dans nos rétines et nos mémoires collectives. Le peuple chilien, ses luttes et résistances, ont été dans les cœurs et les mobilisations de nombre de collectifs de solidarité de par le monde. Aujourd’hui, ces mémoires de la répression, de l’exil, du combat pour la défense des droits humains, continuent à marquer nos représentations de ce pays du Cône sud. Mais le Chili n’a pas seulement vécu une tragédie : le début des années 1970 est d’abord celui d’un processus populaire et (pré)révolutionnaire extraordinaire qui a fait trembler l’ordre établi. Ce dossier de Contretemps revient au travers de divers articles, entretiens et formats sur ces milles jours qui continuent à interpeller le monde et les réflexions stratégiques des gauches radicales.
« Coup d’État », « dictature », « illibéralisme », des qualificatifs que l’on entend, par ci par là, depuis la dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron à la suite des élections européennes. Et d’autant plus depuis la nomination de Michel Barnier en tant que premier ministre, homme issu d’une formation minoritaire à l’Assemblée nationale.
Alors, qu’en est-il ? La constitutionnaliste Eugénie Mérieau propose un pas de côté. Bien que toute cette « séquence » soit conforme, si on suit la lettre, à la Constitution de la Ve République, encore faut-il s’intéresser à la nature même de cette dernière. Et remonter à la manière dont, dès l’annonce de sa mise en place, la Ve République s’inscrit dans une logique de Coup d’État.
Aussi, et peut-être surtout, voir un peu au-delà : comprendre comment l’État d’urgence permanent, notamment sous la présidence d’Emmanuel Macron, a subvertit l’État de droit en profondeur. Si bien que la France n’a aujourd’hui rien à envier aux pays voisins qualifiés, parfois avec un certain dédain, « d’illibéraux ».
Les macronistes ont organisé le barrage bourgeois en faisant une coalition avec le RN. Cela a abouti à la nomination de Michel Barnier.
Emmanuel Macron voulait une cohabitation avec le RN pour l’affaiblir en vue de 2027. C’était sans compter l’arrivée en tête du NFP qu’aucun politicien de droite, éditorialiste et sondagier n’avait anticipé. Après avoir réussi à se maintenir deuxième force politique en nombre de députés grâce au barrage anti-RN, les macronistes devaient donc organiser le barrage bourgeois, anti-gauche, en faisant une coalition avec le RN. Cela a pris près de deux mois et a abouti à la nomination de Michel Barnier ce jeudi 5 septembre. Qui est ce sinistre personnage et qu’est-ce que cette nomination nous dit de la période ?
Les élections ne servent plus à rien : c’est ce qu’on appelle une dictature
« Une dictature, c’est un régime ou une personne ou un clan décident des lois. Une dictature, c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais.” Cette phrase est de Macron lui-même. Nous y sommes. Macron est un Trump qui a réussi : malgré une défaite électorale cuisante et claire, ce dernier est parvenu à rejeter les trois messages de cette élection, c’est-à-dire le barrage anti-RN, l’arrivée en tête de la gauche et le désir d’une cohabitation. Il y est parvenu en faisant alliance avec le RN pour barrer la gauche et nommer un premier ministre qui assure la continuité de sa politique et de son contrôle.
Eugénie Mérieau, juriste, politiste, constitutionnaliste, enseignante à l’université de Paris 1, a récemment publié deux ouvrages : La dictature, une antithèse à la démocratie ? et Géopolitique de l’état d’urgence. Sous couvert de petits livres sur le droit et les régimes politiques - sujet qui généralement nous échappent par leur formalisme et leur rigorisme tout abstrait -, ce sont peut-être les textes les plus denses, diaphanes et radicaux, les plus heureusement et puissamment critiques de la « tradition libérale-impériale » qu’on ait pu lire depuis bien longtemps. Dans cet entretien, non seulement la démocratie libérale représentative ne nous apparaît plus comme l’antithèse de la dictature mais comme l’une de ses modalités possibles ; mais la dictature même, par l’étude comparative des régimes politiques, se voit revêtue de toutes les propriétés que valorise en réalité le néo-libéralisme économique et ses critères de sanctification.
« Une autre caractéristique souvent associée au syndrome narcissique tient au désir de rester au pouvoir à vie. Or, la présidence à vie est également rationnelle : une fois hors du pouvoir miroite la perspective d’une condamnation, d’un assassinat, d’une saisine des biens ou les trois à la fois. (…) les dictateurs sont en ce sens les prisonniers de leur passé répressif. Pour la plupart d’entre eux, il n’y a pas d’« exit strategy », à l’exception de l’exil »
Henry Kissinger est l’un des diplomates les plus célèbres du monde. C’était aussi l’un des plus dangereux. Il a consacré sa vie à soutenir des dictatures autour du monde, à anéantir des mouvements communistes et empêcher les peuples d’être maîtres de leur destin, en tant que conseiller des présidents des États-Unis.