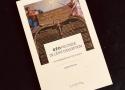Alors que l’état d’exception, c’est-à-dire « l’exception au principe de l’État de droit », semble s’imposer comme la réponse « technique » à tous les défis (terrorisme, pandémies, crises de la démocratie représentative,…), Eugénie Mérieau en propose une analyse historique, juridique et géopolitique.
Elle explique tout d’abord que l’état d’exception a pour effet juridique « objectif » de concentrer le pouvoir aux mains de l’exécutif, et comme effet juridique « subjectif » de suspendre les droits et les libertés individuels garantis. S’il a pour « ancêtres antiques et médiévaux » la dictature romaine et les différentes conceptions de l’État de nécessité, il appartient avant tout à la tradition libérale de l’État de droit et naît avec les Lumières. Son ancêtre direct est la loi martiale, d’invention britannique, qui consiste en un triple-transfert, en temps de paix, du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire des autorités civiles vers les autorités militaires. Tout comme la dictature romaine s’exerçait en état d’urgence à l’intérieur des frontières de la ville où aucune formation militaire ne pouvait pénétrer armée en temps ordinaire, et en permanence aux frontières de l’empire, la pensée libérale établit une distinction et une coexistence entre différents ordres juridiques, en fonction des territoires et des populations concernées.
(...)
« L’état d’urgence n’est pas une aberration ou anomalie dans une histoire linéaire de progrès vers les droits de l’homme et la démocratie… Il est la condition même de cette histoire, de ce « conte de fée » libéral, qui doit rester caché dans la périphérie, comme on cache les canalisations d’évacuation des eaux usées… sans lesquelles pourtant rien ne fonctionne et tout suinte de façon pestilentielle. » Avec cet exposé extrêmement clair et synthétique, Eugénie Mérieau replace l’état d’urgence, « zone d’ombre de la pensée libérale », au centre de la théorie et de la pratique du droit libéral : « L’état d’urgence produit de l’exclusion pour mieux pouvoir clamer l’universalisme de l’État de droit. »
« Coup d’État », « dictature », « illibéralisme », des qualificatifs que l’on entend, par ci par là, depuis la dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron à la suite des élections européennes. Et d’autant plus depuis la nomination de Michel Barnier en tant que premier ministre, homme issu d’une formation minoritaire à l’Assemblée nationale.
Alors, qu’en est-il ? La constitutionnaliste Eugénie Mérieau propose un pas de côté. Bien que toute cette « séquence » soit conforme, si on suit la lettre, à la Constitution de la Ve République, encore faut-il s’intéresser à la nature même de cette dernière. Et remonter à la manière dont, dès l’annonce de sa mise en place, la Ve République s’inscrit dans une logique de Coup d’État.
Aussi, et peut-être surtout, voir un peu au-delà : comprendre comment l’État d’urgence permanent, notamment sous la présidence d’Emmanuel Macron, a subvertit l’État de droit en profondeur. Si bien que la France n’a aujourd’hui rien à envier aux pays voisins qualifiés, parfois avec un certain dédain, « d’illibéraux ».